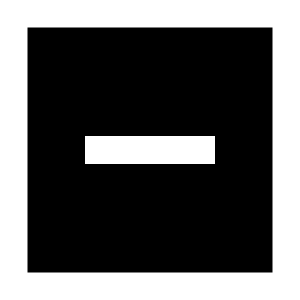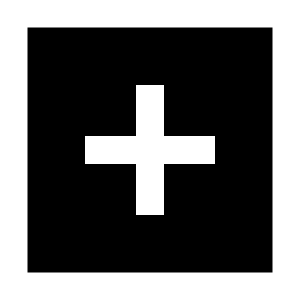Jean-Laurent CASSELY, Denis MAILLARD - 31 Oct 2019
Identités et systèmes de valeurs
L’identité culinaire, un avantage comparatif dans la mondialisation ?
← RETOUR AUX NOTESJean-Laurent CASSELY, Denis MAILLARD - 31 Oct 2019
L’identité culinaire, un avantage comparatif dans la mondialisation ?
L’identité culinaire, un avantage comparatif dans la mondialisation ? Jean-Laurent Cassely vient de publier No Fake, une « contre histoire de notre quête d’authenticité » (Arke éditions 2019). Plutôt que de faire la recension d’un ouvrage qui a été déjà beaucoup chroniqué, nous avons demandé à Denis Maillard* de discuter directement avec Jean-Laurent Cassely** d’un point de son ouvrage très présent mais peu remarqué jusqu’ici : le lien entre mondialisation et recherche d’authenticité culturelle. Le débat est ouvert. Denis Maillard - Outre les articles et études que tu livres au fil de l’eau – je pense à la note de la fondation Jean Jaurès sur la « génération cariste » suite au mouvement des Gilets jaunes ou encore au long article sur la France de Stéphane Plazza en juillet 2018 – c’est le deuxième ouvrage de facture sociologique que tu consacres aux transformations de l’identité contemporaine à travers les modes de vie et de consommation : après La révolte des premiers de la classe, voici donc No Fake. Si le premier entendait décrire le besoin d’authenticité qui pousse des diplômés à troquer le costume et l’open space contre le tablier du néo-artisan urbain, le second cherche à en donner une théorie générale à travers une « contre histoire de notre quête d’authenticité ». Mais le tour de force de ce livre est précisément de ne pas se perdre en théorie pour faire toucher du doigt au lecteur les évolutions en cours à travers des exemples iconiques de la culture urbaine, notamment les fameux hipsters. Je n’ai pas de critiques majeures à formuler à un ouvrage qui se lit d’un trait et apporte de nombreuses explications à des phénomènes que j’aperçois « en bas de chez moi », mais que je suis souvent dans l’incapacité de comprendre par moi-même. J’ajoute que la notion de « trente génériques » pour caractériser cette période qui va du début des années 1980 aux années 2010 est particulièrement bien trouvée et éclairante. C’est le moment de l’arrivée en France de Mc Donald’s ou de Disney comme d’autres franchises mondialisées qui vont peu à peu repeindre notre pays aux couleurs d’un monde aseptisé qui s’enracine pourtant en périphérie des villes, devient une part de notre imaginaire alors qu’il pourrait être de partout ailleurs. C’est en réaction à cette période « générique » ou substituable que les hipsters vont chercher à affirmer une identité « authentique ». Las, comme à chaque radicalisation de la modernité, la quête d’authenticité est vouée à l’échec et la recherche de tradition n’est qu’un symptôme de son inexistence. Tout cela débouche alors sur ce que tu nommes le fake (le faux généralisé ou « l’authentoc ») dans la lignée de Baudrillard ou de Guy Debord. A l’aide de nombreux exemples culinaires (mais pas seulement), tu illustres parfaitement cette idée pour arriver petit à petit à deux notions dont on ne comprend pas toujours si elle se renforcent ou se contredisent : d’une part l’hyper France, d’autre part l’airpsace. L’hyper France, c’est cette France revisitée : les Trente glorieuses expurgée de leurs relents trop forts pour le goût du jour, c’est-à-dire des « routiers dans leur jus » sans sexisme, sans cigarette et sans gluten. L’airspace, à l’inverse, c’est le lieu authentique selon les canons de l’esthétique mondialisée par Instagram et AirBnB : on a envie d’y être, on s’y sent comme chez soi sauf que cette sensation de familiarité instantanément identifiable est fausse : ça pourrait être n’importe où tant les images d’appartements chaleureux ou de recettes de toasts à l’avocat savoureux se ressemblent toutes, qu’il s’agisse de Berlin ou de Paris, de Londres ou de Brooklyn. Je cite ce quartier de New-York à dessein tant l’airspace semble en réalité une gigantesque brooklynisation du monde. On voit donc bien comment l’hyper France et l’airspace, s’ils partagent le goût du faux, ne signifient pas tout à fait la même chose : une identité locale remise au goût du jour pour l’une, une identité mondiale symbole du goût du jour pour l’autre. C’est à partir de cette distinction que je voudrais argumenter dans notre discussion afin d’introduire une dimension présente dans l’ouvrage mais un peu cachée : la mondialisation et la nécessaire reconfiguration des cultures nationales que celle-ci implique. J’ai d’ailleurs été étonné, dans les différents entretiens et recensions que j’ai lus depuis la sortie du livre, de ne rien voir ou presque à ce sujet (excepté le long entretien à Pop up urbain en juillet). Pour commencer, je partirai de l’analyse de « La mondialisation de l’Etat-nation » que fait Marcel Gauchet dans le chapitre VI de son dernier livre Le nouveau monde (Gallimard 2017). Dans ce chapitre profond de ce livre profond, il montre que, contrairement à ce que certains imaginent spontanément, la globalisation n’est pas le dépassement de la nation. Bien au contraire, elle représente l’achèvement de cette forme politique qui, selon lui, a définitivement conquis la planète à travers cette phase de mondialisation. Elle représente une « organisation de l’humanité en entités politique à la fois distinctes et semblables » faisant ainsi de l’Etat-nation « la forme politique du monde mondialisé ». Cette situation paradoxale a une conséquence que Gauchet définit ainsi : pour les nations, désormais, « le lointain est devenu proche car la nouveauté est que l’extérieur est à l’intérieur et que l’intérieur se détermine dans sa forme même en fonction de l’extérieur » (p 242). A travers cette formulation un peu absconse, Marcel Gauchet explique qu’à l’heure de la mondialisation, l’étonnant triomphe de la nation se paie d’un véritable choc identitaire. En effet, le fait que la nation soit devenue la seule forme politique légitime, implique une redéfinition de l’identité de chacune d’entre elles pour tenir compte de l’existence des autres. Aucun Etat impliqué dans ce processus de globalisation ne peut donc plus définir son identité historique comme il l’avait fait jusqu’ici. Dans un autre livre destiné à un public plus large – Comprendre le malheur français (Stock 2016) – Gauchet explique cette nouvelle situation des nations dans la mondialisation : alors que les nations se définissaient « de l’intérieur, sur la base de leurs histoires, de leurs conflits, de leurs vicissitudes », la mondialisation les oblige à un autre exercice. En effet, elle « leur impose l’extraversion de leur identité historique. C’est par rapport à l’extérieur qu’il faut mesurer la singularité qui fait ce que vous êtes » (P29-30 – c’est moi qui souligne). Evidemment, pour un pays comme la France qui se veut universel et, pour une part, a dominé le monde, cette relativisation est un véritable choc culturel. Si l’on suit Gauchet, il est donc désormais impossible se définir soi-même sans tenir compte de ce qui n’est pas soi. La mondialisation accouche du renforcement des nations, mais… des nations ouvertes les unes sur les autres, non pas tellement économiquement mais surtout culturellement, du point de vue de leur identité profonde. C’est là que j’en reviens à ton livre qui me semble illustrer cette nouvelle expérience identitaire à travers les restaurants hispters. En effet, ce que tu appelles le moment « générique » correspond à cette période où la France, saisie d’une sorte de stupeur identitaire devant l’accélération de la mondialisation après la chute de l’Union soviétique, ne sait pas comment réinterpréter son histoire à l’aune de son ouverture sur le monde. Elle l’emprunte donc à d’autres sources à travers Disney, Mc Donald’s et autres. La réaction hispster qui va surgir à partir des années 2010 correspondrait alors moins à une révolte contre la France moche ou contre l’absence d’identité de ses non-lieux culturels et culinaires, qu’à une entrée définitive dans la mondialisation des élites urbaines françaises capables désormais de dire ce qu’est la France en tenant compte de l’image que celle-ci a dans le monde. L’hyper France correspond alors bien à ce que dit Gauchet de la nation à l’heure globale : offrir, à travers l’aménagement des lieux et les recettes de cuisine, une image de soi qui tienne compte de l’extérieur tout en étant acceptable aussi par la culture française traditionnelle. Ce qui pose la question éminemment politique de savoir quels traits culturels, identifiés par l’extérieur, les Français veulent-ils mettre à l’honneur à l’intérieur de leurs frontières ? S’agit-il du béret et de la baguette comme le propose une marque comme Big Fernand ? Privilégie-t-on le savoir-vivre et le luxe comme le proposent les marques de cosmétiques ? Ou, pourquoi pas, veut-on se présenter au monde à partir d’un certain rapport entre les sexes, de la laïcité ou encore de la sécurité sociale ?... Qu’est-ce que les autres voient de nous que l’on se reconnaît également et qu’il nous serait possible de réinterpréter pour en faire un avantage comparatif dans la mondialisation des identités ? C’est la nouvelle équation de l’identité nationale que ton livre ne fait qu’effleurer mais qu’il permet de penser. Cette identité est évidemment fake par rapport aux siècles qui lui ont permis de se façonner : elle n’est qu’une réinterprétation des signes sous lesquels apparaît la France aux yeux du monde, mais elle dit plus que la culture originale ce qu’est la France dans le monde. C’est paradoxalement l’élément contemporain de la souveraineté. D’ailleurs, c’est lorsque tu parles de l’exemple de Big mamma – que tu appelles ironiquement « l’usine à vrai » –, que l’on prend la mesure de cette expérience identitaire globale. Qu’est-ce que Big Mamma après tout ? Une chaîne de restauration italienne « vraiment » italienne (de la nourriture aux serveurs et de la décoration à la faconde de ceux qui vous accueillent), mais créée par… des Français !... à Paris ! Soit l’identité italienne revisitée par l’extérieur de l’Italie ; une identité italienne globale… Ce qui amène un élément supplémentaire par rapport à l’analyse de Marcel Gauchet : la redéfinition de soi qui tienne compte d’un extérieur de soi n’est pas susceptible d’un enracinement chez soi. En effet, à l’heure de la mondialisation, l’identité nationale est un signifiant flottant, disponible, quasiment en open source et susceptible d’interprétation par n’importe qui du moment qu’il est reconnu à la fois par le monde entier et par les nationaux eux-mêmes. On peut alors imaginer que pour garder la main sur leur identité, les nations ont intérêt à proposer dans d’autres parties du monde une définition globale d’elle-même. Un peu comme le fait Eataly qui vient d’ouvrir à Paris et dont on peut penser qu’il cherche à concurrencer la définition de l’italianité détenue jusqu’à présent chez nous par les Français de Big Mamma. J’en veux pour preuve l’initiative « Ita0039 » que le ministère de l’agriculture italien associé au premier syndicat agricole et à la Poste de ce pays ont prise récemment : délivrer aux commerces et restaurants italiens hors d’Italie un label d'« italianité » en contrôlant leur usage de produits venant de la péninsule. Ainsi 7000 labels sont à distribuer chaque année. Désormais ne sera donc italien à l’étranger que ce que l’Italie voudra bien définir comme italien. On s’en tient pour le moment aux produits pour lutter contre « l’italian sounding » et l’agromafia mais pourquoi pas demain qualifier l’ambiance, la langue utilisées etc. Alors qu’à l’origine c’étaient essentiellement les immigrés qui, en emportant un peu de leur pays à la semelle de leurs souliers, ouvraient un restaurant à Paris, Berlin ou New-York l’hybridant rapidement au goût local, c’est désormais à n’importe qui d’ouvrir son restaurant typique et sans concession. Avec la mondialisation identitaire – qui, on l’aura compris, n’est pas une uniformisation culturelle –, les objets, les monuments, le territoire, la nourriture perdent de leur centralité au profit des seules images de ces objets sans rapport avec leur origine réelle ; ils ne sont alors que réinterprétation à partir de l’idée qu’on se fait d’eux et de l’image que le monde entier en a. L’Italie peut donc être à Paris comme la France s’inventer à Londres du moment que les signes émis correspondent à l’idée que tout le monde – Italiens et Français compris – se font de l’Italie ou de la France. On assiste à une nouvelle étape dans l’histoire que tu racontes dans ton livre : l’airspace pourrait ainsi avoir tendance à s’effacer peu à peu devant l’hyper vrai identitaire. Dans ce monde, l’anglais est le liant commun à toutes ces identités : si « Mamma » signe bien son origine italienne, « big » en revanche cherche à parler à tous. Quant au toast à l’avocat, bien sûr, il fait encore de la résistance, mais pour combien de temps ? Jean-Laurent Cassely - Je crois que nous sommes d'accord sur l'essentiel : le mouvement culturel hipster est une forme de backlash occidental vis-à-vis de la mondialisation, exactement comme les revival religieux et identitaire, sauf que contrairement à ces derniers, le premier n'a – à première vue – pas de programme politique clair. J'utilise la formule ironique d'identité branchée malheureuse pour résumer cette contradiction. Pour le dire autrement, les hipsters aspirent au retour au passé dans l’assiette seulement (et dans leur salon vintage) alors que les réactionnaires au sens strict, l’attendent dans la société toute entière et tentent de l’obtenir par les urnes, ne se contentant pas des filtres Instagram. Pour répondre à ta question, je me suis replongé, comment souvent lorsqu'il est question d'Hyper France, dans les pages de La carte et le territoire de Michel Houellebecq. C'est un roman qui tourne autour des questions de représentation artistique, à commencer par la représentation du territoire lui-même. En cela, l'écrivain y prolonge la réflexion entamée avec Plateforme sur le devenir touristique du monde, pour employer une tournure typiquement houellebecquienne. Rappelons que le titre de ce roman publié il y a bientôt dix ans, en 2010, fait référence au travail du protagoniste Jed Martin, artiste d'abord conceptuel qui finit par rencontrer le succès lorsqu'il expose des détails de cartes Michelin. La carte devenant plus intéressante que le territoire qu'elle est censée décrire. En ouvrant le roman de Houellebecq pour écrire ce texte, je suis tombé sur un passage dont je n'avais aucun souvenir, mais qui donne un bon aperçu de la thèse défendue. Alors que le protagoniste principal, qui tente de prendre du recul sur sa vie, se retrouve, dans un moment terriblement houellebecquien, à l'hôtel Kyriad du centre de Beauvais, il croise un autre solitaire, un Japonais qui commande une entrecôte dans le restaurant de l’hôtel. Le Japonais lui apprend qu'il s'est retrouvé à Beauvais pour réparer une machine-outil vendue par son employeur à la dernière draperie locale encore en activité : c'est un petit conte de la mondialisation économique et de ses conséquences culturelles – ce pauvre japonais apparaît totalement déphasé à Beauvais. Venons-en à présent à Gauchet qui, comme tu l’écris, pense qu’ « il est donc désormais impossible se définir soi-même sans tenir compte de ce qui n’est pas soi ». L'un des aspects centraux du roman est la relation des personnages au territoire. Olga, la compagne russe de Jed Martin, est éditrice d'un guide touristique, French Touch. « À travers l'ouvrage la France apparaissait comme un pays enchanté, une mosaïque de terroirs superbes constellés de châteaux et de manoirs, d'une stupéfiante diversité mais où, partout, il faisait bon vivre. » Les deux protagonistes divergent sur la manière d'appréhender la restauration dans le guide à destination des visiteurs étrangers. Faut-il proposer aux touristes de la cuisine fusion ou, au contraire, opérer un retour aux sources, devenir un guide de puristes intransigeants figés dans le passé. C'est la deuxième option qui l'emporte, ce qu'exprime Olga en ces termes : « Mais moi je suis une touriste, je veux du franco-français. Un truc franco-marocain ou franco-vietnamien, ça peut marcher pour un restaurant branché du canal Saint-Martin ; sûrement pas pour un hôtel de charme dans le Cantal. » On a ici une distinction entre AirSpace d’une part (canal Saint-Martin) et Hyper France (le Cantal). Pour appuyer sa ligne éditoriale « hyper française », Olga commande un sondage auprès des établissements référencés par son guide. Résultat : « Quelle que soit la région, les restaurants se prévalant d'une image “ traditionnelle ” ou “ à l'ancienne ” enregistraient des additions supérieures à 63% à l'addition médiane. Les cochonnailles et les fromages représentaient des valeurs sûres, mais surtout les plats s'articulant autour d'animaux bizarres, à connotation non seulement française mais régionale, tels que la palombe, l'escargot ou la lamproie, atteignaient des scores exceptionnels. » À la lecture de ce compte-rendu de sondage fictif, on comprend que la clientèle étrangère vote pour le traditionalisme culinaire. Le rejet de l'AirSpace est explicite : « Nous avons probablement eu tort de nous concentrer sur les goûts d'une clientèle anglo-saxonne à la recherche d'une expérience gastronomique light [...], lit-on dans le rapport issu de ce sondage [il n'y a vraiment que Houellebecq pour imaginer un faux sondage dans un roman...] Cette clientèle, en réalité, n'existe pas [... ] Nos nouveaux clients, nos clients réels, issus de pays plus jeunes et plus rudes, aux normes sanitaires récentes et de toute façon peu appliquées, sont au contraire à la recherche, lors de leur séjour en France, d'une expérience gastronomique vintage, voire hardcore ; seuls les restaurants en mesure de s'adapter à cette nouvelle donne devraient mériter, à l'avenir, de figurer dans notre guide. » A première vue, c’est Olga qui a raison : j’ai récemment dîné dans une institution de la néo-brasserie de l’Est parisien dans lequel, tarifs de la carte des vins oblige, on ne trouvait que des Américains, et quelques Japonais. D’ailleurs, à chaque fois que je tombe sur un restaurant franchouillard particulièrement bon, il y a un couple de jeunes Japonais dans la salle qui déguste des cuisses de grenouille, des tripes ou tout autre option hardcore du terroir que personne en France ou presque ne commande. En résumé, l’AirSpace serait l’équivalent de la cuisine fusion, mondialisée, une sorte d’Eurovision culinaire, alors que l’Hyper France exprimerait un retour aux sources, un fondamentalisme de l’assiette. Mais voilà, j’ai l’impression que les deux concepts ont tendance à se rejoindre. Pour te convaincre que l'AirSpace et l'Hyper France relèvent en fait de la même logique, je vais prendre l’exemple du magazine gratuit édité par Aéroports de Paris, Paris Worldwide, que j’ai feuilleté par hasard il y a quelques semaines. Ce magazine, écrit en français et en anglais, propose une sélection des lieux et des expériences qui valent le détour sur le sol français. On peut donc imaginer que ses pages vont privilégier des adresses typiques, authentiques. Or, à ma grande surprise, nombre d’adresses de la rubrique Restauration appartiennent plutôt à la famille des lieux AirSpace. Par exemple, un petit-déjeuner chez Nord, Nord, un « bistrot lumineux qui attire déjà tous les gens du quartier. La raison ? Une déco d’époque (cuisine semi-ouverte, murs en briques, etc.), une terrasse ensoleillée, un service attentif et une carte qui vise juste. Le matin, c’est avocado toats, jus pressés, tartines, œufs à la coque (4€), granolas maison et scones avec un café sélectionné par le torréfacteur Lomi. » Ce n’est pas la première fois que je tombe sur des avocado toats mêlés à une carte plus traditionnelle, par exemple j’ai récemment aperçu une entrée « œuf mayo et tartine à l’avocat ». Un peu comme si on intégrait du vocodeur à des polyphonies corses… Mais curieusement, cela fonctionne assez bien. Ce que montre cet exemple, c’est que désormais les attentes touristiques et celles des nationaux ont tendance à converger : les touristes recherchent un style international avec option française et, dans le même temps, les Français ont développé une approche touristique, réinventée de leur propre patrimoine. Peut-être que d’ici une ou deux générations, nous ne ferons plus la différence entre ces diverses influences, et qu’un style french touch international aura intégré tous ces apports nouveaux issus de la globalisation culinaire des grandes métropoles – l’avocado toast étant l’exemple typique du plat qui signale l’appartenance à une classe mobile et cosmopolite. De mon point de vue, l’Hyper France est donc tout simplement la déclinaison locale de l'AirSpace. C’est pourquoi j’aime bien dire que l’Hyper France, c’est le troquet dans son jus à la Jean Gabin plus le wifi, moins le gluten : une signature de marque de l’identité français pour la consommation intérieure et extérieure, l’idée-clé étant selon moi que désormais nos attentes sont à peu près les mêmes que celles des étrangers, puisque nous nous définissons par rapport à l’extérieur. Ou pour reprendre tes mots, l'Hyper France est un lieu français « authentique selon les canons de l’esthétique mondialisée par Instagram et AirBnB ». D'ailleurs, j'ai longtemps hésité entre « Hyper France » et une autre expression, l’ « Air France » : Air France sonnait bien et avait l'avantage d'évoquer (à travers la référence au groupe Air) l'esthétique de la French touch, courant musical électro qu'on a souvent défini comme à la fois hyper-français, voire parisien, et totalement globalisé dans son approche (musique électro, chant en anglais, univers visuel piochant dans toutes les pop cultures). Grâce à ta proposition d'échange et à ton interprétation très originale des thèmes abordés dans No Fake, nous avons fait dialoguer certaines thèses de Marcel Gauchet avec l'univers de Big Mamma, et je pense que c'est une grande première ! Pour finir, l’aboutissement ultime de cette nouvelle approche de l’identité serait une déterritorialisation complète des expériences de consommation. Comme tu l’écris, « l’Italie peut donc être à Paris comme la France s’inventer à Londres du moment que les signes émis correspondent à l’idée que tout le monde – Italiens et Français compris – se font de l’Italie ou de la France. » Et si c’était la prochaine étape ? Ainsi, j’ai commencé à travailler sur le concept de 11ème arrondissement hors les murs. Il s’agit d’essayer d’identifier des quartiers, peut-être des villages, qui possèdent certains attributs qui les rapprochent de la vie du 11ème arrondissement de Paris : une certaine densité de bars et de restaurants, d’espaces voués au bien-être, de coworking. L’idée étant qu’on pourrait vivre dans le 11ème un peu partout sur terre, à l’image de l’AirSpace. En lisant des essais de prospective écrits au cours des années 1990 sur le cyberespace, je me suis rendu compte que ce fantasme d’une fin de la géographie était omniprésent, comme par exemple avec le concept d’hyperville développé par Paul Virilio, qui a entamé cette réflexion dès les années 1980 avec un livre fascinant, L’espace critique. Pour lui, à partir du moment où les nouvelles technologies de l’information permettaient de convoyer instantanément des images d’un endroit à en autre, l’idée même de lieu perdait de sa substance, puisque le lieu suppose que ce qui est quelque part n’est pas ailleurs, et inversement. Eataly invalide cette règle de la physique puisqu’avec lui, l’Italie peut se déplacer dans l’espace, en tout cas créer de petites enclaves italiennes à l’extérieur du territoire national. C’est aussi la grande idée contenue dans le concept d’AirSpace, sorte de lieu générique authentique qui se déplace avec les réseaux sociaux, comme dans les films d’horreurs high tech dans lesquels les virus ou les monstres se propagent avec les échanges dématérialisés. Mais en réalité je n’y crois pas trop. Je trouve que l’idée de Brooklyn à Paris et inversement fonctionne bien, mais qu’elle n’est pas généralisable à l’ensemble du territoire : il faudrait que tout le monde bouge tout le temps pour que ce genre d’utopie / dystopie d’après les lieux se réalise, or nous savons que ce n’est pas le cas, comme en témoigne l’opposition Somewhere Vs Anywhere popularisée par David Goodhart, à propos de la société britannique clivée entre un groupe mobile (à tous les sens du terme) et une population plus ancrée. L’AirSpace devrait rester à l’avenir un loisir de privilégiés. Denis Maillard - Cela sera mon dernier commentaire car je vois en te lisant que nous sommes à peu près d’accord sur les deux points que j’avais soulevés au départ : à la fois la redéfinition identitaire de la Nation à partir d’un extérieur de soi et la convergence – au moins théorique – de l’Airspace et de l’Hyper France. Je précise, « au moins théorique », car le bémol que tu émets à la fin de ta réponse sur cette possible réconciliation me pousse à poursuivre encore un peu cette discussion. La convergence n’aura pas lieu, m’objectes-tu. Celle-ci supposerait une mobilité sociale généralisée très hypothétique que la sociologie politique bat en brèche. C’est notamment le cas de David Goodhart qui, à partir de l’opposition entre enracinés (somewhere) et nomades (anywhere), illustre ce souci du monde de la vie quotidienne stable qui serait l’apanage des catégories populaires menacées par la mondialisation. On observe souvent la révolte des Gilets jaunes avec ce type de lunettes idéologiques. Je ne les conteste pas en bloc, j’émets seulement quelques réserves qui vont me permettre de poursuivre sur ce que tu dis de Michel Houellebecq. Je parle dans mon livre, Une colère française – ce qui a rendu possible les Gilets jaunes, du monde du back office dans lequel la différence de statut entre salariés, intérimaires, auto-entrepreneurs, indépendants, artisans ou commerçants s’efface au profit d’une homogénéité d’un mode de vie. Celle-ci se caractérise d’abord par un type de labeur au service des autres, souvent émietté, payé à la tâche ou la journée, avec des horaires contraints et décalés, entraînant ensuite une forte mobilité en périphérie des villes. Tu as été le premier, dans ton étude sur les caristes, à remarquer que le gilet jaune que l’on enfilait pour manifester la samedi permettait de faire le lien entre ces deux aspects de la vie : une extrême mobilité au service de l’épanouissement ou du bien-être des autres travailleurs ; c’est ce que j’appelle le back office. J’insiste là-dessus parce que cette situation sociale permet, me semble-t-il, de relativiser les analyses entre Somewhere et Anywhere ou, pour ce qui concerne notre pays, entre la France du mouvement, celle qui serait « en marche », opposée à une France immobile, enracinée, qui se révolterait face à cette violation de son mode d’existence. Ce contre quoi grondent les Gilets jaunes, c’est, bien au contraire, l’obstruction faite à leur mobilité, l’entrave mise à l’autonomie individuelle que permettent la voiture et le travail. Il y a bien sûr une dimension de défense des modes de vie, mais je ne suis pas sûr que celui-ci soit construit à partir d’un éloge de la lenteur, de l’enracinement ou de la tradition... Ce mode de vie, en effet, c’est aussi celui d’une certaine mobilité (sociale, économique et culturelle). Et dans ce contexte, la véritable exclusion, c’est l’immobilité ! Ce que montre excellemment bien le beau roman photos de Vincent Jarousseau, Les racines de la colère (Les arènes). Si je m’attarde sur ce point, c’est pour « sauver » l’idée d’une mobilité généralisée. Non pas tant que j’en sois un fervent défenseur, mais principalement parce qu’elle me semble correspondre à une aspiration profonde de cette nouvelle définition des Nations dont on a parlé plus haut. En matière culturelle, cette propension à la mobilité porte un nom, celui que lui donne Houellebecq que tu cites fort opportunément : le « devenir touristique du monde ». Mais encore faut-il s’entendre sur cette expression. Il ne s’agit pas de dire que chacun va réellement voyager partout – ce qui n’est ni physiquement, ni économiquement ni écologiquement soutenable –, pas d’instruire non plus une critique de la laideur ou de l’inculture des touristes, ni même de s’insurger contre une homogénéisation visuelle et culinaire du monde. C’est précisément le contraire. J’entends le « devenir touristique du monde » comme le corolaire de cette définition de l’identité nationale de l’extérieur. Citons encore une fois Marcel Gauchet : « Hors de cette organisation politique [la nation], sans ce prodigieux effort pour l’habiter ensemble, le monde ne serait qu’un chaos impraticable réservé à des hardis explorateurs. Au lieu de quoi, la figure typique du monde mondialisé, plus encore celles du banquier ou du marchand, est celle du touriste, figure miraculeuse en sa paisible liberté de se promener partout, et figure accablante, en son inconscience de l’infrastructure organisationnelle requise pour garantir cette tranquillité d’âme, avec l’égo-ethnocentrisme qui ne manque pas d’en résulter. Cette innocence dans l’irresponsabilité en fait l’illustration en acte de la méconnaissance que ce monde secrète à son propre sujet et qui rend sa réussite si problématique… » (p 286). Dit autrement, la rançon paradoxale de la mondialisation, c’est cette affirmation de l’Etat-nation dans sa nouvelle forme identitaire dont la figure archétypique est… le touriste ! Il n’y a donc pas que des touristes à la surface du globe mais dans notre rapport aux autres nations nous ne pouvons faire autrement que de nous en tenir à un rapport touristique. C’est là que l’on retrouve notre hyper France et ce concept stimulant sur lequel tu travailles : le « 11ème arrondissement hors les murs ». En effet, si nous ne sommes pas tous des touristes réels, si la lutte contre le dérèglement climatique nous enjoint de ne plus trop prendre l’avion et si pourtant nous sommes dans un devenir touristique du monde, alors c’est moins les hommes qui sont invités à bouger que les références culturelles qui se promènent à la surface du globe come des succédanées de souveraineté nationale. C’est le sens de la concurrence entre Eataly et Big mamma : les hommes restent sur place, le voyage est immobile mais il est intense ; seuls circulent alors les produits qui viennent soutenir la mondialisation des signes culturels authentiques ; en l’occurrence des AOP comme la mozzarella, le jambon, le vin, l’huile ou la farine. Celle-ci est d’ailleurs, le seul produit qui ne soit pas en food court au Ground control de la Gare de Lyon : la farine issue de blés anciens servant à réaliser les pâtes fraîches de Solina, ce laboratoire de la « raviolution », a obtenu la permission d’importation précisément car il s’agit d’un signe culturel authentique. On n’est donc plus dans le temps – il y a une quinzaine d’années – où on ne jurait que par Second life : le monde est bien réel et ouvert au tourisme. Mais ce tourisme est d’une nature spéciale : il suppose la floraison d’espaces identitaires authentiques et contrôlés au cœur des nations. De cette manière, notre hyper France a donc vocation à s’exporter. Denis Maillard* : philosophe politique de formation, consultant en relations sociales ; auteur de Une colère française – ce qui a rendu possible les gilets jaunes (co-édition L’Observatoire / L’Aurore, 2019) Jean-Laurent Cassely** : journaliste, auteur de La révolte des premiers de la classe (Arkhe, 2017) et No fake (Arkhe, 2019).