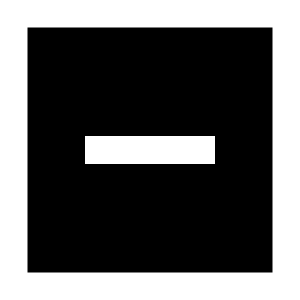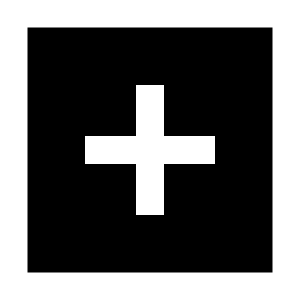Laurent Bouvet - 29 Juin 2018
Identités et systèmes de valeurs
Vous avez dit idéologie ?
← RETOUR AUX NOTESLaurent Bouvet - 29 Juin 2018
Vous avez dit idéologie ?
La chute du Mur de Berlin en 1989 a relancé le débat sur la « fin des idéologies » qui a déjà eu lieu au tournant des années 1950–1960. La fin du communisme dans sa formule originelle, soviétique, et son évolution dans les pays s’en réclamant encore (Chine notamment) a toutefois ouvert un moment nouveau de l’histoire contemporaine qui apparaît à bien des égards comme celui du triomphe d’une seule Weltanschaung (conception du monde), celle d’un capitalisme lié à la démocratie libérale. On aurait pu croire que le caractère lui-même profondément idéologique de cette victoire marquait la fin de « l’ère des idéologies » ainsi que l’a nommée Claude Lefort. Aujourd’hui, face au double défi de l’islamisme et du national-populisme, il n’est pas du tout certain que non seulement nous en ayons fini avec les idéologies mais que ce qui a fait le succès de la démocratie libérale liée au capitalisme soit de nature à pouvoir l’emporter à nouveau.-- L’idéologie est née comme concept philosophique avec le marxisme (en particulier dans les écrits du « jeune Marx » tels que Critique de la philosophie du droit de Hegel, Manuscrits de 1844, L’Idéologie allemande). L’idéologie apparaît alors comme une « pensée théorique qui croit se développer abstraitement sur ses propres données, mais qui est en réalité l’expression de faits sociaux, particulièrement de faits économiques, dont celui qui la construit n’a pas conscience, ou du moins dont il ne se rend pas compte qu’ils déterminent sa pensée. Très usuel en ce sens dans le marxisme » (Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie).
L’invention du terme lui-même est pourtant antérieure à l’approche marxiste. Il apparaît pour la première fois chez Destutt de Tracy dans son Mémoire sur la faculté de penser (1798). Ce qu’il nomme idéologie est précisément cette science de la faculté de penser ou plus exactement comme l’indique le Littré : une « science des idées considérées en elles-mêmes, c’est-à-dire comme phénomènes de l’esprit humain. Sens plus restreint : science qui traite la formation des idées, puis système philosophique d’après lequel la sensation est la source unique de nos facultés. Théorie des idées selon Platon ». Tracy désigne cette « science » de manière polémique en l’opposant à la métaphysique classique, dans la mesure où celle-ci désigne « une science qui traite de la nature des êtres, des esprits, des différents ordres d’intelligence, de l’origine des choses, de leurs causes premières » (Mémoire).
Or, aux yeux des penseurs des Lumières, tout cela est discrédité puisqu’invalidé par le développement de la science moderne; l’idéologie témoigne d’une compréhension « scientifique » de la pensée et des idées. Le terme est développé en ce sens par Tracy dans son Eléments d’idéologie, gros traité de « nouvelle philosophie » en 4 volumes, publié entre 1801 et 1815. Le terme est alors utilisé pour désigner les derniers penseurs des Lumières, qui entre science et philosophie en appellent à une forme de « super-rationalisme » (Necker, Madame de Staël) qui débouche au début du XIXe siècle sur le libéralisme politique (Benjamin Constant). C’est d’ailleurs Napoléon qui inaugure le sens négatif du terme en qualifiant ces auteurs qui le combattent d’Idéologues.
L’idéologie comme illusion
C’est donc avec Marx que l’idéologie revêt son sens contemporain. Celle-ci fonctionne pour lui à la fois comme un phénomène d’illusion et d’inversion: le monde des idées communes au sein d’une société n’est pas le simple produit des opinions mais l’expression de forces sociales dont les structures peuvent être mises en lumière par une analyse matérialiste — qui montre qu’entre l’infrastructure économique et la superstructure idéologique d’une société, il y a un lien et que c’est justement ce lien qui permet de parler d’une structure « sociale ». Marx introduit l’idéologie à travers une métaphore physique ou physiologique : celle de l’image photographique ou rétinienne inversée. La première fonction de l’idéologie étant la production d’une image inversée de la réalité — Marx suit en cela un modèle avancé par Feuerbach qui a décrit la religion comme un reflet inversé de la réalité (Thèses sur Feuerbach), avant de l’étendre à la compréhension du monde dans son ensemble.
La connotation négative de l’idéologie est ainsi fondamentale car elle apparaît comme le moyen général par lequel le processus de la vie réelle est obscurci. L’opposition principale n’est pas entre la science et l’idéologie, comme elle le deviendra plus tard, mais entre la réalité et l’idéologie : le contraire de l’idéologie n’est pas la science mais la réalité (comme praxis). Le processus idéologique est ainsi le suivant : chacun agit puis imagine ce qu’il fait de manière approximative — il existe une réalité sociale dans laquelle les gens combattent pour gagner leur vie par exemple. Cette réalité est ensuite représentée dans le « ciel des idées », mais faussement, comme ayant une signification autonome, comme faisant sens sur la base d’éléments qui peuvent certainement être pensés ou imaginés mais non vécus. Ce que Marx critique, c’est donc bien l’idée selon laquelle l’idéologie s’opposerait, en négatif, au réalisme de la vie pratique.
« Les hommes se sont toujours fait jusqu’ici des idées fausses sur eux-mêmes, sur ce qu’ils sont ou devraient être. C’est d’après leurs représentations de Dieu, de l’homme normal, etc., qu’ils ont organisé leurs relations. Les inventions de leur cerveau ont fini par les subjuguer. Eux les créateurs, ils se sont inclinés devant leurs créations. Délivrons-les des chimères, des idées, des dogmes, des êtres d’imagination qui les plient sous leur joug avilissant. Révoltons-nous contre cette domination des pensées. Apprenons aux hommes, dit l’un, à changer ces illusions contre des pensées qui soient conformes à la nature de l’homme ; apprenons-leur, dit l’autre, à prendre à leur égard une attitude critique ; à les chasser de leur tête, dit le troisième ! Vous verrez alors s’écrouler la réalité existante. »
Karl MARX, L’Idéologie allemande, 1845–1846, « Avant-propos » (tr. M. Rubel, Gallimard, 1982).
Mais une idéologie n’est pas seulement l’expression inversée de la réalité, elle est aussi un moyen d’action puisqu’elle est un ensemble d’idées, de mythes, de représentations… qui gouvernent la conduite des individus ou des groupes humains en structurant leur imaginaire. Ce sont donc des « structures » qui aliènent, mystifient ou réifient dans la mesure où elles s’imposent à l’homme comme une vision du monde qui le rend étranger à lui-même afin de conserver une situation sociale, présentant celle-ci comme un ordre naturel, éternel. Une seconde étape du concept marxiste naît ainsi à partir du moment où le marxisme prend la forme d’une théorie et finalement d’un système. Cette étape voit le jour dans Le Capital et les écrits marxistes ultérieurs, particulièrement dans l’œuvre de Friedrich Engels. Le marxisme devenant lui-même un corps de savoir scientifique. C’est à partir de ce moment que l’idéologie va s’opposer à la science, elle-même identifiée au corps de connaissances et au Capital comme à son paradigme. Aussi l’idéologie ne recouvre-t-elle plus seulement la religion au sens de Feuerbach ou la philosophie de l’idéalisme allemand tel que le voyait le jeune Marx critique de Hegel, mais elle inclut également toutes les approches de la vie sociale pré-scientifiques. L’idéologie est alors rejetée comme significative de toute ce qui précède la découverte « scientifique » de l’analyse du monde et de sa réalité sociale par le marxisme.
« Ce n’est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c’est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience. À un certain degré de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en collision avec les rapports de production existants, ou avec les rapports de propriété au sein desquels elles s’étaient mues jusqu’alors, et qui n’en sont que l’expression juridique. Hier encore formes de développement des forces productives, ces conditions se changent en de lourdes entraves. Alors commence une ère de révolution sociale. Le changement dans les fondations économiques s’accompagne d’un bouleversement plus ou moins rapide dans tout cet énorme édifice. Quand on considère ces bouleversements, il faut toujours distinguer deux ordres de choses. Il y a le bouleversement matériel des conditions de production économique. On doit le constater dans l’esprit de rigueur des sciences naturelles. Mais il y a aussi les formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques, philosophiques, bref les formes idéologiques, dans lesquelles les hommes prennent conscience de ce conflit et le poussent jusqu’au bout. On ne juge pas un individu sur l’idée qu’il a de lui-même. On ne juge pas une époque de révolution d’après la conscience qu’elle a d’elle-même. Cette conscience s’expliquera plutôt par les contrariétés de la vie matérielle, par le conflit qui oppose les forces productives sociales et les rapports de production. Jamais une société n’expire avant que soient développées toutes les forces productives qu’elle est assez large pour contenir ; jamais des rapports supérieurs de production ne se mettent en place avant que les conditions matérielles de leur existence ne soient écloses dans le sein même de la vieille société. »
Karl MARX, Critique de l’économie politique, « Avant-propos de 1859» (tr. M. Rubel, Gallimard, 1965).
L’idéologie comme légitimation
Dès lors tout ce qui échappe à l’organisation du système marxiste ou le contredit devient idéologie. L’utopie revêt ainsi un caractère idéologique — et en particulier, aux yeux de Marx, les utopies socialistes du XIXe siècle : celles de Saint-Simon, Fourier, Cabet, Proudhon, etc. Le socialisme utopique est idéologique alors que le socialisme scientifique décrit la réalité et prescrit son amélioration (Engels). L’utopie est idéologie dans la mesure où elle est non scientifique, pré-scientifique voire anti-scientifique. Cette extension de la « critique de l’idéologie » à de nombreux domaines par les différents courants du marxisme au XXe siècle (Ecole de Francfort par exemple : Jürgen Habermas, La Technique et la science comme idéologie, 1968) a agi en fait comme une légitimation progressive et une justification du concept lui-même. L’approche marxiste entraîne en effet une confusion entre la fonction et le contenu de l’idéologie. Fonction de renversement de l’ordre social, mais aussi contenu quasi-religieux.
C’est précisément là, selon Paul Ricœur notamment, que se situerait l’erreur de Marx, dans l’extension de la critique idéologique à l’ensemble des activités humaines (L’Idéologie et l’utopie, 1997). Car il apparaît très vite que défendre ses idées conduit tout simplement à « faire de l’idéologie ». Comment ne pas tenir soi-même un discours idéologique à partir du moment où tout ce que l’on pense, dit et la manière dont on agit renvoie à des intérêts que nous ne connaissons pas ou dont nous n’avons pas conscience ? C’est le « paradoxe » mis en évidence par Karl Mannheim lorsqu’il remarque que le concept d’idéologie ne peut s’appliquer à lui-même (Idéologie et utopie, 1929).
Si l’on reprend la théorie de Marx, on peut en effet constater que l’idéologie, telle qu’il la dénonce, répond à une fonction essentielle au sein de la structure sociale : les hommes en produisant leurs conditions d’existence se « produisent » eux-mêmes selon la « condition dernière de la production ». La reproduction des conditions de la production permettant de maintenir la domination d’une classe sur une autre — classiquement, dans la tradition marxiste, cette fonction est assurée par l’Etat comme appareil répressif. Or, comme l’a montré Max Weber, la domination dans les sociétés modernes ne peut s’exercer par la force, elle ne peut s’imposer que si elle est légitime (Economie et société, 1921).
La notion d’idéologie n’est donc plus seulement un facteur d’illusion, elle apparaît bien également comme un facteur de légitimation.
S’inscrivant dans la tradition marxiste qu’il tente d’enrichir, Louis Althusser met en avant ce rôle nouveau de l’idéologie à travers la fonction de ce qu’il appelle les « appareils idéologiques de l’Etat » (AIE). A ses yeux, « l’idéologie fait organiquement partie, comme telle, de toute totalité sociale. Tout se passe comme si les sociétés humaines ne pouvaient subsister sans formations spécifiques, ces systèmes de représentations — de niveau divers — que sont les idéologies… Seule une conception idéologique du monde a pu imaginer des sociétés sans idéologies, et admettre l’idée utopique d’un monde où l’idéologie — et non telle de ses formes historiques — disparaîtrait sans laisser de trace pour être remplacée par la science » (Pour Marx, 1965).
Le moment totalitaire
La dérive du « tout idéologique » dans la manière de comprendre le monde et les sociétés modernes a rencontré au XXe siècle un phénomène qui en a poussé la logique jusqu’à son terme : le totalitarisme. Hannah Arendt a bien mis en lumière la potentialité totalitaire de ce qu’elle nomme « la logique de la pensée idéologique » (Les Origines du totalitarisme. Le système totalitaire, 1951). A ses yeux, l’essence même de l’idéologie se dévoile dans le phénomène totalitaire, à travers la constitution d’un système de domination et de déshumanisation de l’homme. Elle montre comment l’idéologie s’avère totalitaire dans son principe même. Pour Arendt, « une idéologie est très littéralement ce que son nom indique : elle est la logique d’une idée. Son objet est l’histoire, à quoi ‘l’idée’ est appliquée ; le résultat de cette application n’est pas un ensemble d’énoncés sur quelque chose qui est, mais le déploiement d’un processus perpétuellement changeant. L’idéologie traite l’enchaînement des événements comme s’il obéissait à la même ‘loi’ que l’exposition de son ‘idée’ » (Ibid., tr. fr., 1972, p. 216).
« Les idéologies sont connues pour leur caractère scientifique : elles allient approche scientifique et résultats d’ordre philosophique, et ont la prétention de constituer une philosophie scientifique. Le mot d’« idéologie » semble impliquer qu’une idée peut devenir l’objet d’une science au même titre que les animaux sont l’objet de la zoologie : le suffixe logie dans idéologie comme dans zoologie, ne désignerait rien d’autre que les log les discours scientifiques tenus à son propos. S’il en était vraiment ainsi, une idéologie ne serait qu’une pseudo-science, qu’une pseudo-philosophie, transgressant à la fois les limites la science et celles de la philosophie. Le déisme, par exemple serait l’idéologie traitant l’idée de Dieu, qui intéresse la philosophie, à la manière scientifique de la théologie pour laquelle Dieu est une réalité révélée. Une théologie qui n’est pas fond sur la révélation d’une réalité donnée, mais traite Dieu comme une idée, serait aussi aberrante qu’une zoologie qui ne sera plus certaine de l’existence physique, tangible, d’animaux. Cependant nous savons que cela n’est que partiellement vrai. Le déisme, bien qu’il nie la révélation divine, ne s’en tient pas à des discours « scientifiques » sur un Dieu qui n’est qu’une « idée » ; il se sert de l’idée de Dieu afin d’expliquer le cours du monde. Les « idées » qui sont au centre des doctrines — race dans le racisme, Dieu dans le déisme, etc. — ne constituent jamais l’objet des idéologies et le suffixe logie ne désigne pas seulement un ensemble de propositions « scientifiques ».
Hannah ARENDT, Le Système totalitaire, 1951 (tr. J.-L. Bourget, R. Davreau, P. Lévy, Le Seuil, 1972), p. 215–216.
L’idéologie est en effet comprise dans une histoire précise, dans la mise en place d’une narration à l’attention des hommes. L’idéologie s’appuie sur une lecture du monde, sur une idée qui autorise l’explication de l’histoire de manière incontournable. Elle permet d’expliquer le passé, de connaître le présent et de prévoir l’avenir. Aussi l’idéologie se caractérise-t-elle, selon Arendt, par son détachement vis-à-vis de l’expérience et de la réalité — conformément à la définition marxiste — en tentant d’imposer sa propre réalité (une « super-réalité ») à partir de l’idée qui est en son cœur. Le but étant de rendre cohérente la réalité elle-même par rapport à l’axiomatique de base de l’idéologie : la lecture raciste de la société pour le nazisme ou celle de la lutte des classes pour le marxisme par exemple. L’idéologie exclut ainsi, en même temps que la réalité qu’elle entend tordre ou substituer, tout ce qui ne rentre pas dans son cadre d’explication du monde : elle devient une pure action et un pur mouvement qui crée son propre développement sans plus tenir compte du reste ; elle devient selon Arendt, un « jeu irréel sans conséquences » (Les Origines du totalitarisme. L’impérialisme, 1951).
Sans conséquences pour les tenants de l’idéologie elle-même bien sûr, car le totalitarisme auquel conduit l’idéologie est destructeur de l’humanité même, d’abord de celle de la victime puis dans un processus dialectique auquel il ne peut échapper du bourreau lui-même, celui qui est le « sujet idéal du règne totalitaire », dont Arendt dit qu’il n’est « ni le nazi convaincu, ni le communiste convaincu, mais l’homme pour qui la distinction entre fait et fiction et la distinction entre vrai et faux n’existent plus » (Le système totalitaire, op. cit., p. 224).
L’idéologie de la fin des idéologies
De la mise à jour de l’horreur totalitaire au XXe siècle à la levée de l’hypothèque communiste en 1989, à l’occasion de la chute du Mur de Berlin et de l’effondrement des régimes prosoviétiques d’Europe de l’Est, la question de la place de l’idéologie dans la politique contemporaine a été posée de manière radicale. Toute explication idéologique du monde pouvant ainsi être rejetée comme susceptible d’une dérive totalitaire par elle-même. Ce rejet de l’idéologie en politique, dont témoignent bon nombre de philosophies contemporaines qui tendent à dénoncer les « grands récits » en même temps que les aspirations à l’universalisme au nom d’une fin tragique de la modernité dans les drames totalitaires du XXe siècle (c’est le cas du postmodernisme par exemple, cf. Jean-François Lyotard, L’Inhumain. Causeries sur le temps, 1988), se trouve aussi soumis à un questionnement, dans le sens où la victoire de « l’idéal démocratique » reconnue comme « définitive », au point de parler d’une « fin de l’histoire » depuis 1989, rend tangible une nouvelle étape dans la manière d’appréhender la politique : dépassement du clivage droite-gauche, extension de la régulation par le droit, lutte pragmatique contre de nouveaux risques « non idéologiques » : santé, environnement, violence…).
« La disparition du marxisme-léninisme d’abord en Chine puis en Union soviétique équivaudra à sa mort en tant qu’idéologie vivante dotée d’une importance historique mondiale. Il peut certes demeurer quelques croyants isolés dans des lieux comme Managua, Pyongyang ou Cambridge (Massachusetts) : le fait qu’il n’y ait plus un seul grand État où le marxisme-Iéninisme soit chose vivante sape complètement sa prétention d’être à l’avant-garde de l’histoire de l’humanité. Et la mort de cette idéologie signifie que l’esprit du Marché commun ne cessera de se renforcer dans les relations internationales et que la probabilité d’un conflit à grande échelle entre États ne cessera de diminuer.
Cela n’implique nullement la fin des conflits internationaux en tant que tels. Car le monde serait alors divisé en deux parties : l’une qui serait historique, l’autre qui serait post-historique. Un conflit entre des États encore situés dans l’histoire, ou entre ces derniers et ceux qui se situent à la fin de l’histoire, serait encore possible. Il y aurait toujours un niveau élevé, voire croissant, de violence ethnique et nationaliste, car il s’agit là de pulsions qui ne sont pas complètement apaisées, même dans certaines parties du monde « post-historique ». Les Palestiniens et les Kurdes. Les Sikhs et les Tamouls, les catholiques irlandais. Les Wallons, les Arméniens, les Azéris, continueront à avancer leurs revendications insatisfaites, ce qui implique que le terrorisme et les guerres de libération nationale continueront de représenter un chapitre important de l’ordre du jour international. Mais pour ce qui est des conflits à grande échelle, ceux-ci exigent la présence de grands États encore sous l’emprise de l’histoire : ce sont eux qui semblent sur le point de quitter la scène.
La fin de I’histoire sera une période fort triste. La lutte pour la reconnaissance, la disposition à risquer sa vie pour une cause purement abstraite, le combat idéologique mondial qui faisait appel à l’audace, au courage et à l’imagination, tout cela sera remplacé par le calcul économique, la quête indéfinie de solutions techniques, les préoccupations relatives à l’environnement et la satisfaction des exigences de consommateurs sophistiqués. Dans l’ère post-historique, il n’y aura plus que l’entretien perpétuel du musée de l’histoire de I’humanité. Je ressens moi-même, et je vois autour de moi d’autres ressentir, une nostalgie puissante de l’époque où l’histoire existait. Cette nostalgie continuera, pour quelque temps encore, à alimenter la concurrence et le conflit dans le monde post-historique lui-même. Même si je reconnais qu’elle est inévitable, j’éprouve les sentiments les plus ambivalents à l’égard de la civilisation qui s’est créée en Europe après 1945, avec ses surgeons américains et asiatiques. Et peut-être la perspective même des siècles d’ennui qui nous attendent après la fin de l’histoire va-t-elle servir à remettre l’histoire en marche… ».
Francis FUKUYAMA, « La fin de l’histoire ?», Commentaire, n° 47, automne 1989, p. 468–469.
Pourtant, la victoire tant proclamée d’une démocratie libérale et d’un capitalisme débridé peut à son tour revêtir les habits de l’idéologie dans le sens où le discours même sur la fin des idéologies serait un discours idéologique, celui d’une idéologie qui ne dirait pas son nom, d’une « idéologie invisible » selon Claude Lefort.
« Nous manquerions peut-être la fonction idéologique essentielle du discours de la consommation. Car la fiction qu’il accrédite, c’est celle d’un monde où l’homme ne se verrait renvoyer que les signes de l’homme. Un homme dont l’espace est offert à tous les parcours ; où tout, pour peu qu’on en ait les moyens, est saisissable ; où la vision, la manipulation des objets, le mouvement sont multipliés sans obstacle par l’instrument, et comme ajustés à un tout visible, un tout manipulable, un tout explorable. Qu’on considère seulement la petite fable publicitaire qui nous présente la maison de nos rêves, achevée, préparée à nous recevoir, dont la clé est sur la serrure ; elle résume un très long discours sur le social : celui-ci enseigne que les choses du dehors sont là, au-dedans, que l’univers est aménagé pour l’homme, que la nature est l’environnement. Là, l’idéologie va jusqu’au bout de son travail, elle installe la grande clôture ; mais en la rendant invisible, en faisant l’économie d’un énoncé sur l’homme total et la société totale.
Mais qu’elle aille au bout de son travail, cela doit-il nous faire penser que ses contradictions sont résolues ? Comment le seraient-elles s’il est vrai que la société historique est cette société qui mine toute représentation de son institution ?
Plus le discours sur le social cherche à coïncider avec le discours social, plus il s’applique à maîtriser le mouvement immaîtrisable de l’institution, à s’emparer des signes de l’instituant, et plus il court le danger de perdre la fonction qu’assumait jusqu’alors l’idéologie : la légitimation de l’ordre établi. Les principes de l’idéologie dite bourgeoise peuvent bien être encore invoqués, ils n’ont plus de force, ils ont été rejetés à la périphérie du discours.
Pour la première fois, sans doute, naît une critique, qui n’est pas la propriété de quelques individus, qui chemine dans des groupes multiples, encore obscurément, dont quelques grandes révoltes de jeunes ont porté la marque. Critique ambiguë, toujours prête, sans doute, à se réinscrire dans le champ de l’idéologie, mais dont la portée dépasse les expressions de fait, parce qu’elle met en évidence l’impuissance du discours dominant à affirmer sa légitimité. Elle ne porte pas, croyons-nous, contre une forme particulière de pouvoir, contre un régime socio-économique particulier, elle s’attaque à ce que les Anglo-Saxons nomment l’Establishment, le modèle même de l’organisation, de la rationalité scientifico-technique, de la consommation. Elle fait vaciller le pouvoir de la représentation et resurgir la question de l’être du social. »
Claude LEFORT, « L’Ere de l’idéologie », Encyclopaedia Universalis, Symposium — Les Enjeux, tome 2, 1994, p. 1284.
Pour lui en effet, l’idéologie trouve toujours un nouveau terrain d’expression. Il s’agit aujourd’hui d’un libéralisme triomphant mais simpliste, qui ne laisse que peu de place à l’extérieur de ce qu’il définit, idéologiquement, comme le « cercle de la raison » — à l’intérieur duquel doit se dérouler le débat politique, économique, social… Le monde échapperait donc constamment à une véritable « fin des idéologies » telle qu’elle est régulièrement proclamée (Raymond Aron, « Fin de l’âge idéologique » in L’Opium des intellectuels, 1955 ; Daniel Bell, The End of Ideology, 1960), sans jamais renoncer pourtant à en finir avec l’idéologie. Cette quête apparaissant comme essentielle à une survie des hommes entre illusion sur leur propre identité et leur propre nature, et légitimation de leur inlassable démarche politique.
De nouvelles idéologies
Aujourd’hui, on assiste à la montée en puissance de deux nouvelles formes idéologiques avec, d’une part, le déploiement, notamment dans le monde occidental, d’un national-populisme (sous la forme notamment d’une dissociation entre la démocratie et le libéralisme) et, d’autre part, le développement de l’islamisme. La première soulève de lourdes questions de l’intérieur même de notre propre « modèle » idéologique, celui qui s’est illustré par le « triomphe » de 1989-1990. On lira avec profit sur le sujet le texte de Brice Couturier, « La démocratie libérale face à une double menace », L’Aurore, juin 2018 ; quand la seconde interroge, de l’extérieur, la possibilité même de sa survie historique.
L’islamisme est en effet une idéologie à base religieuse, et non plus ethno-raciale ou sociale comme au XXème siècle. Une idéologie originale car constituée à partir d’apports théoriques différents, nés d’interprétations radicales ou fondamentalistes de l’islam, qu’il s’agisse du salafisme, du wahhabisme saoudien ou des contributions diverses des Frères musulmans par exemple. Le caractère idéologique de cette nouvelle poussée islamiste est néanmoins de plus en plus discernable, notamment à partir de la mise en place d’un « état islamique » en Syrie et en Irak en 2014, bien au-delà des groupes djihadistes et terroristes qui se battent pour faire progresser ces formes rigoristes ou politiques de l’islam depuis des années — tels que les Talibans ou Al Qaïda par exemple.
L’islamisme revêt en effet les traits de l’idéologie dans son sens abouti du XXème siècle aussi bien à travers le caractère de légitimation de la violence en raison d’une idée que de l’organisation d’une structure politique autour de cette idée. La manière dont il se répand, mêlant prosélytisme religieux et modes de domination politiques est tout aussi caractéristique. Le continuum qui s’est peu à peu installé entre les écrits théoriques de quelques auteurs, les discours et la prédication les diffusant, le contrôle social imposé aux populations musulmanes à partir de ceux-ci jusqu’au terrorisme de masse dessinent en effet un projet global qui s’inscrit dans le temps comme dans l’espace, celui d’une conquête et d’une soumission à partir de l’idée théologico-politique de départ.
On assiste donc bien aujourd’hui à un processus qui va bien au-delà de la conquête arabe ou de la conquête ottomane telles qu’elles ont pu se dérouler dans l’histoire, puisque cette idée centrale qui fonde l’idéologie islamiste se pense comme un modèle de société radicalement alternatif à la Modernité elle-même – très loin d’une simple lecture rigoriste du texte sacré. Ce qui signifie que l’affrontement avec l’islamisme qui est perçu par certains comme un « choc de civilisation » au sens huntingtonien, peut plus simplement être compris d’abord et avant tout un affrontement idéologique entre ceux qui refusent la soumission à cette interprétation de l’islam, musulmans compris donc, et ceux, au sein de l’islam, qui sont prêts à mourir pour l’imposer.
Dans un tel cadre, ce que l’on pourrait appeler le socle idéologique occidental qui lie étroitement libéralisme, démocratie et capitalisme (dans sa version régulée notamment), est bel et bien confronté à un nouveau défi de l’ordre de ceux qu’il a connus au XXème siècle. La question, fondamentale, qui nous est désormais posée est de savoir si l’idéologie libérale qui a pu un moment être pensée comme celle de la fin des idéologies peut encore assumer et assurer un tel affrontement et, donc, si elle peut s’avérer aussi efficace qu’elle l’a été dans le passé pour triompher de ses ennemis.
Auteur : Laurent Bouvet, professeur de science politique, Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, auteur de L’Insécurité culturelle, Fayard, 2015.
Mots-clefs : idéologie, totalitarisme, nazisme, fascisme, communisme, libéralisme, islamisme