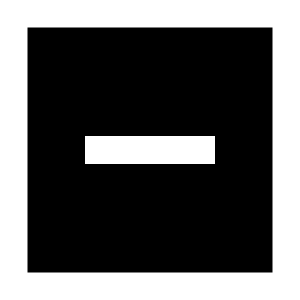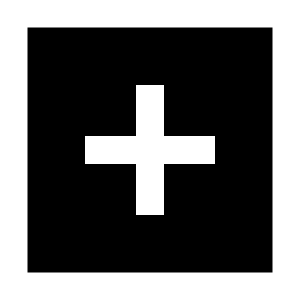Mona OZOUF, Jean GLAVANY - 21 Avr 2020
Institutions, ressources et territoires
Entretien avec Mona OZOUF : « La force de l’idée républicaine (…) n’a rien perdu de son éclat »
← RETOUR AUX NOTESMona OZOUF, Jean GLAVANY - 21 Avr 2020
Entretien avec Mona OZOUF : « La force de l’idée républicaine (…) n’a rien perdu de son éclat »
Il y a longtemps qu’à « L’Aurore » nous avions envie de rencontrer Mona Ozouf et d’avoir avec elle un entretien sur les grandes valeurs et les convictions profondes qui fondent notre engagement commun au sein de notre think-tank. Pourquoi Mona Ozouf ? Oh ! Simplement parce que nous avons de l’admiration - et de l’affection- pour cette grande intellectuelle, pas seulement parce qu’elle est authentiquement une femme de gauche et qui s’assume comme telle, mais parce qu’étant philosophe de formation devenue historienne, ou historienne de passion qui n’a jamais renoncé à porter un regard philosophique sur l’histoire, elle porte mieux que quiconque en elle le sens du temps, de sa lenteur, de la relativité et de l’utilité des compromis. Ce que d’aucuns appelleraient sagesse. Je voudrais la remercier très chaleureusement d’avoir accepté cette rencontre et de sa disponibilité si courtoise et chaleureuse. Cet entretien a eu lieu à son domicile parisien il y a quelques mois et nous avons pu profiter du confinement pour le finaliser grâce aux moyens modernes de communication. Jean GlavanyJean Glavany : “ L’Aurore” est un think-tank que nous avons créé avec Gilles CLAVREUL, ancien Délégué interministériel à la lutte contre les discriminations et un certain nombre d’universitaires, intellectuels et hauts fonctionnaires autour de quelques convictions et valeurs . Nous nous définissons d’abord comme républicains au sens historique et permanent du terme, de gauche, de la gauche de gouvernement, réformiste et social-démocrate, libéraux au sens politique du terme, convaincus de la nécessité d’un Etat et d’une puissance publique forte, et européens, profondément européens mais sévères avec les europhiles béats qui ne voient pas la crise très profonde que traverse notre Europe et qui sont donc dans l’incapacité d’y répondre . Ma première question vise simplement à vous faire réagir a cette “déclaration de principes”
Mona OZOUF : Je me sens en accord spontané avec la carte d’identité que dessine votre préambule. De gauche ? En effet, par fidélité à la tradition familiale et à l’enseignement de l’école républicaine. Libérale ? Au plan politique assurément, convaincue qu’il faut laisser à chaque individu la liberté de définir et de mettre en œuvre sa conception de la vie bonne. Européenne ? Certes, et pleinement satisfaite par la définition que donne Jacques Delors de l’Europe : une fédération d’Etats-nations. Républicaine ? Bien entendu. Persuadée, d’autre part, que la frontière droite/gauche tient toujours. A quoi reconnait- on la gauche ? D’abord à ce qu’elle tient un discours de la volonté : quand on lit que l’être humain doit toujours être « la force impulsive de sa destinée », on peut être sûr de son origine de gauche, même si en l’occurrence, il s’agit de Madame de Staël. Ensuite à ce qu’elle est orientée vers l’avenir ; Clemenceau disait qu’il reconnaissait sans coup férir un discours de Jaurès : tous les verbes, disait-il, y sont au futur. Enfin l’opposition d’une gauche à une droite structure toujours notre façon de penser. Elle combine en effet la simplicité de l’affrontement binaire avec la complexité des situations : elle permet de distinguer une gauche de la droite, une droite de la gauche, comme une droite de la droite et une gauche de la gauche.
Toutefois, à peine énoncé, cet assentiment global soulève à chaque pas des perplexités et des doutes.
JG : Quels sont ces doutes, ces perplexités ?
MO: On peut se contenter d’un ou deux exemples. Ainsi, pour me classer à gauche, j’ai évoqué l’attachement à la tradition familiale, donc une valeur de fidélité, plus conservatrice que progressiste. Et j’ai présenté mon républicanisme comme une évidence, alors que les définitions du républicanisme sont éminemment variables : il suffit de songer à l’usage du mot. Tout le monde aujourd’hui se dit républicain, y compris à l’extrême droite, convoite les bénéfices promis à l’affichage de l’épithète, voire se l’approprie abusivement comme l’a fait récemment, pas gêné, un de nos partis politiques. Se dire républicain, c’est souvent s’opposer à un être hybride, porteur de menaces diverses, tantôt européen, voire fédéraliste, tantôt libéral, tantôt régionaliste, souvent islamiste, et parfois, tout cela à la fois.
JG : Vous semblez dire que la tradition est antinomique des valeurs de gauche. Pourtant il y a une tradition des combats de la gauche non ? Les combats, la commune, la résistance, les conquêtes sociales, les liberté conquises, 1981...
MO: En effet, il y a tout un mémorial des grandes dates, des combats et des conquêtes. Mais précisément : voilà qui nous invite non seulement à réfléchir à la pureté originelle de l’idée républicaine, mais aussi à son histoire
« Pour devenir citoyen, il faut accepter de suspendre l’association politique à la dissolution des liens sociaux antérieurs. C’est une manière de coup de force philosophique, exigeant et ascétique. Et comme tel, il trouve très vite ses limites. »
JG: Pouvez-vous revenir sur ces deux phases, l’origine et l’histoire qui a suivi ?
MO: A l’origine, tel qu’il sort de la Révolution française, le républicanisme se caractérise par l’abstraction. Il plaide la rigoureuse égalité en droits de tous les hommes, ce qui implique la neutralisation de leurs différences concrètes, et de leurs attachements particuliers. De là, une citoyenneté qui ne connait que des individus et non des groupes (qu’ils soient religieux, ethnologiques, régionaux, sexuels ou générationnels). Le républicanisme s’édifie sur l’arrachement à ces groupes, comme une expérience pure, sans enracinement historique ou social. « Notre histoire, dit Rabaut Saint Etienne, n’est pas notre code ». Ce qui veut dire que la loi de nos comportements doit être cherchée, non dans le passé, mais dans l’exercice de la raison. Ce moment d’abstraction est indispensable pour atteindre ce qu’il y a de commun chez des individus pourtant si divers. On voit tout de suite le caractère normatif, radical, et même extrémiste du modèle républicain. Pour devenir citoyen, il faut accepter de suspendre l’association politique à la dissolution des liens sociaux antérieurs. C’est une manière de coup de force philosophique, exigeant et ascétique. Et comme tel, il trouve très vite ses limites.
JG: A quoi pensez-vous ?
MO: Au fait qu’on se pose immédiatement la question : est-ce ainsi que les hommes vivent ? La radicalité du projet doit très vite composer avec une société qui lui résiste et avec des hommes qui ne savent, ni ne désirent vivre selon des normes abstraites. L’histoire de l’idée républicaine est celle des accommodements et des compromis successifs : on voit la République, qui voulait n’avoir affaire qu’à des individus, reconnaître l’existence des groupes particuliers et leur accorder des, droits, tantôt sociaux (reconnaissance des syndicats), tantôt religieux (jours fériés, calendriers scolaires calqués sur le calendrier liturgique), tantôt culturels (associations locales et patrimoniales). Il y a donc eu au cours de l’histoire une redéfinition considérable du modèle républicain initial, qui prohibait, comme le souhaitait Rousseau, les sociétés partielles.
JG: Je vous propose, si vous le voulez-bien, que l’on organise notre échange désormais plus précisément sur la République justement en partant de ses caractéristiques telles qu’elles sont édictées par notre constitution, la Constitution de 1958 : La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale . On peut reprendre ces termes ?
MO: Une et indivisible : il faut d’abord saisir les raisons pour lesquelles la République s’est installée en France sous la bannière de l’unité. Il faut se souvenir que la nation est le produit d’une construction volontaire de l’Etat monarchique dans un pays d’une très grande diversité culturelle, linguistique, juridique, mais auquel la personne du roi assurait une puissante unité charnelle. Mais quand la Révolution, en décapitant le roi, se prive de cette forte image symbolique, il lui faut trouver une légitimité équivalente et renchérir sur la volonté d’unité, qui est visible partout : unité du territoire par le découpage départemental, unité politique par le refus du bicamérisme, unité de la langue par la répression des « patois », unité des esprits enfin, avec l’horreur des « factions ». Du coup, la République n’a pas été neutre à l’égard des diversités régionales et a eu constamment tendance à léser les droits des minorités. En dépit des accommodements qui, comme je l’ai dit, ont été consentis aux particularités, l’esprit d’uniformité n’a cessé de marquer le républicanisme français.
JG: Pourtant, au titre de ces « accommodements, n’est-on pas allé trop loin dans l’acceptation des droits culturels ?
MO: J’ai du mal à entrer dans la question du « trop loin ». Il y a tant de domaines où ce qui frappe, ce n’est pas le laxisme que vous évoquez, mais la rigidité. Voyez seulement la crispation française à l’égard des langues régionales. En 1992, l’année où le Conseil de l’Europe adopte la charte des langues régionales, le législateur français, en déclarant solennellement que « la langue de la République est le français », écarte un amendement pourtant timoré qui suggérait d’ajouter « dans le respect des langues et des cultures régionales minoritaires de France ». Il ne s’agissait pourtant nullement de nier la priorité de la langue officielle, mais de l’équilibrer par une inflexion tolérante. Il y a là du reste une contradiction ; la communauté européenne regroupe dans un vivre ensemble des formes très variées de vie culturelle. Pourquoi l’Etat-nation ne pourrait-il admettre ce même principe à l’intérieur de ses frontières ?
« Le vrai problème, que notre religion de l’indivisibilité nous empêche de voir, c’est de faire place aux particularités dans la vie démocratique, mais à des conditions qu’il faut préciser : que ces droits soient accordés non aux groupes, mais aux individus membres de ces groupes, qui conservent donc la liberté de se désaffilier »
JG: Je sens chez vous l’idée selon laquelle il y aurait un bon communautarisme...
MO: Vous soulignez ici un trait important dans l’évocation, souvent indignée, du communautarisme par nos contemporains. Il s’entend le plus souvent en référence à une communauté menaçante, destructrice du lien social, où il n’est pas difficile de reconnaître l’Islam. Mais si on définit plus sobrement le communautarisme comme la tendance à faire de sa communauté une valeur absolue quels que soient les actes qu’elle commet, et les conséquences de ses actes, alors il n’y a pas de « bon communautarisme ». (Et, au passage, le patriotisme qui juge une entreprise admirable dès lors qu’elle vient de « sa » patrie, est une forme assez réussie de communautarisme) Car il faut maintenir la possibilité pour tout individu de faire sécession avec sa communauté sans être étiqueté comme un traître et puni en conséquence. Le vrai problème, que notre religion de l’indivisibilité nous empêche de voir, c’est de faire place aux particularités dans la vie démocratique, mais à des conditions qu’il faut préciser : que ces droits soient accordés non aux groupes, mais aux individus membres de ces groupes, qui conservent donc la liberté de se désaffilier ; que les particularités, par ailleurs, acceptent de vivre à une place subordonnée. Nous devons distinguer dans nos vies les domaines où elles peuvent s’exprimer et ceux où doit dominer le point de vue collectif. Je reviens à l’exemple de la langue : que la langue officielle est le français, soit. Mais on peut ouvrir libéralement l’apprentissage des langues minoritaires, protéger leur usage, accepter les dénominations géographiques dans la langue régionale. Nous devons résister à cet esprit d’uniformité qui selon Montesquieu caractérise la culture française.
« Il a fallu deux siècles au catholicisme, religion hiérarchique, pour faire sa transaction avec le monde démocratique (…). Or, on demande aux musulmans de faire en quelques décennies le même parcours, rendu plus difficile encore par une religion qui, à la différence du catholicisme, n’a jamais séparé le royaume de Dieu de celui de César. Ce sont des questions immenses, et qui restent ouvertes. »
JG: Notre République n’est pas seulement indivisible, elle est aussi laïque ...
MO :Précisément : voilà qui nous fait revenir à cet autre trait qui caractérise la République : la laïcité, elle aussi menacée par l’Islam intégriste. En effet, mais une fois de plus, la définition de la laïcité a beaucoup bougé depuis le temps où elle s’opposait frontalement au catholicisme, inspirée par une philosophie agnostique et parfois hostile à la religion. Cette laïcité combattante a évolué vers une proposition globale de neutralité. Elle ne concerne pas seulement les opinions religieuses, mais toutes celles qui ont tendance à s’absolutiser. Elle a dû reconnaitre que s’il y a un dogmatisme catholique, il y a aussi un dogmatisme de la raison. Elle a mesuré enfin le bien-fondé de cette proposition de Jaurès, que l’esprit de la laïcité est de tout poser en termes, non de réponses, mais de problèmes.
Mais ceci amène immédiatement un rappel historique et une interrogation. Au cours de l’affrontement séculaire que j’ai évoqué, le catholicisme lui-même a appris à dissocier l’opinion religieuse et l’opinion politique, le spirituel et le temporel. L’Islam le peut-il ? Telle est la grande question. Si on pense que la communauté musulmane est par essence réfractaire aux droits de l’homme, on donne une réponse négative -et désespérante- à la question, et on entre dans la guerre des civilisations. On tient alors pour assuré que l’Islam, soumis quoiqu’il en ait à l’univers rationnel de la pensée scientifique et technique, n’en sera nullement transformé. Ou même, qu’il en sera davantage enclin au fondamentalisme (un fondamentalisme qui renait aussi en Occident, songez seulement au fondamentalisme américain). Mais ceci amène immédiatement un correctif historique : il a fallu deux siècles au catholicisme, religion hiérarchique, pour faire sa transaction avec le monde démocratique, celui des individus libres et égaux. Or, on demande aux musulmans de faire en quelques décennies le même parcours, rendu plus difficile encore par une religion qui, à la différence du catholicisme, n’a jamais séparé le royaume de Dieu de celui de César. Ce sont des questions immenses, et qui restent ouvertes.
« La coïncidence absolue entre le vœu des représentés et celui des représentants est une chimère. Une fois de plus, on sent combien la force de l’idée républicaine a consisté à élaborer des compromis. »
JG: Je poursuis mon survol « constitutionnel »: République indivisible donc, et aussi laïque, la France peut-elle encore se dire démocratique, dans un pays qui connait une crise profonde de la démocratie représentative, marquée par une défiance grandissante à l’égard de ses représentants ?
MO: On peut commencer par dire que la question n’est pas nouvelle. Elle surgit dès la révolution française en faisant naître deux catégories de républicains : les partisans de la démocratie directe, avec en tête un modèle spartiate, ou romain, qui tiennent au mandat impératif et au vote à main levée, ennemis de toutes les médiations ; de l’autre côté les « modernes », partisans de la démocratie représentative, seule solution pour les peuples qu’on ne peut plus réunir sur l’agora. Mais même ceux-ci, tel Condorcet, ont senti que les représentants, catégorie savante, bien disante, et élue comme telle, serait vite soupçonnée de constituer une nouvelle aristocratie, imposant ses vues à la fraction non éclairée de la population. D’où est née très vite l’idée qu’il fallait certes protéger les représentants de la vindicte populaire. Mais qu’il fallait symétriquement protéger les représentés des empiètements de leurs élus. Naissent alors mille procédures pour atténuer, ou corriger, l’écart, entre les décisions des représentants et le vœu populaire et redonner aux représentés leur participation aux décisions : soit par des conventions périodiques, soit par le referendum, soit par le contrôle de constitutionnalité. Ce débat est toujours le nôtre, il a été réactivé par la revendication des gilets jaunes pour un referendum d’initiative citoyenne. Reste que la coïncidence absolue entre le vœu des représentés et celui des représentants est une chimère. Une fois de plus, on sent combien la force de l’idée républicaine a consisté à élaborer des compromis.
JG: Enfin, dernier terme de la définition constitutionnelle , la république est-elle, comme elle l’assure, sociale ?
MO: Entre l’idée républicaine et l’idée socialiste, les rapports n’ont pas toujours été iréniques. Leur long antagonisme a vécu d’une double incompréhension. Les socialistes n’ont cessé de rappeler aux républicains qu’en déclarant l’égalité des hommes, mais en les faisant vivre dans l’inégalité des conditions, ils se rendaient coupables d’une nouvelle imposture : la distinction des droits formels et des droits réels, et le rappel obstiné de ceux-ci, a été la contribution spécifique des socialistes à la pensée politique. Mais cette critique est longtemps restée inintelligible aux républicains : eux croyaient, comme Ledru-Rollin, qu’à partir du moment où le suffrage universel est accordé aux Français, « il n’y a plus de prolétaires en France » : affirmation stupéfiante, mais qui montre à quel point cette croyance républicaine au tout politique devait être, à son tour, inintelligible aux socialistes. Mais cette fois l’écart devait se réduire entre les deux courants. Car le troisième terme de la devise républicaine, la fraternité, comportait en lui-même une correction de l’individualisme. Elle faisait un devoir au républicain d’assurer à chacun, comme membre de l’espèce humaine, la jouissance des droits individuels, de conjurer l’égoïsme de ces droits par la considération de l’être collectif. Cette inflexion fait comprendre que les socialistes aient continué à enraciner leurs espérances dans le suffrage universel, et dans la formation du citoyen par une école délivrée de l’obscurantisme ; à se voir eux-mêmes comme la pointe avancée du mouvement républicain ; une évolution qui a contribué à donner de la crédibilité à l’idée d’une République nouvelle, qui conjurerait l’individualisme républicain par la fraternité sociale.
JG: N’est-ce d’ailleurs point en ce sens qu’il faudrait restaurer l’idée républicaine ?
MO: Le discours de restauration de l’idée républicaine a une fonction précise : permettre à la gauche de retrouver un sujet de fierté, fournir un substitut à l’effondrement du marxisme, tenir un discours de la volonté, toujours populaire à gauche, et rappeler un âge d’or où il y avait une coïncidence entre la volonté politique globale et les projets des individus citoyens. Mais le thème de la restauration est plus difficile à tenir aujourd’hui, notamment en raison d’un avenir devenu infigurable et de la crise de l’idée de progrès.
Toutefois il ne faut pas oublier ce qui fait la force et la séduction de l’idée républicaine : contre la propension à penser l’humanité divisée en races, classes, voire sexes, elle rappelle que le projet d’une communication rationnelle toujours possible entre les hommes n’a rien perdu de son éclat ; contre l’indifférence d’une société atomisée et apathique, elle rappelle que la participation aux affaires publiques est une forme précieuse de l’engagement humain.
Reste alors à corriger la propension du républicanisme à se vivre comme un maximalisme ; ce trait maléfique de la pensée de gauche a été très bien aperçu par Charles Renouvier, le grand penseur, injustement oublié, de la République. Voici ce qu’il écrit, et que devraient garder à l’esprit les hommes politiques de gauche qui se font élire sur des promesses chimériques et se condamnent du même coup à passer pour des traîtres dès le lendemain de leur élection : « les spéculations de la philosophie sociale, surtout quand tout le monde s’en mêle, ont l’inconvénient de dégoûter les esprits des choses réelles, de les empêcher de se contenter de rien tant que le rêve de l’absolu ne s’est pas réalisé et de jeter le discrédit sur toutes les chances d’amélioration et de progrès que la fortune offre aux nations. Tout ce qui n’est pas encore l’idéal est misère ».